
Jean-Pierre Le Goff : "Comment être à la fois conservateur, moderne et social" ...
Propos recueillis par Laetitia Strauch-Bonart
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Jean-Pierre Le Goff, cueilli sur son site Politique autrement et consacré à la question du conservatisme. Sociologue, Jean-Pierre Le Goff a publié de nombreux essais, comme La gauche à l'épreuve 1968-2011 (Perrin, 2011) ou La fin du village (Gallimard, 2012).
Q : Que signifie pour vous le terme de conservatisme ou de conservateur ?
Jean-Pierre Le Goff : Aujourd’hui, les mots se dissolvent dans le flux continuel de la communication et jouent de plus en plus le rôle de marqueurs symboliques. Le « conservatisme » n’y échappe pas. Il fait partie de ces mots-valises qui jouent le rôle de repoussoir permettant de se situer a contrario dans le bon camp. La gauche l’assimile facilement à la « réaction », à l’« extrême droite ». Pour une partie de la droite, le mot est synonyme d’immobilisme, de repli frileux, d’opposition à toute réforme. Contre cette confusion, il faut revenir sur ses origines, son évolution et la signification nouvelle qu’il peut prendre aujourd’hui.
À l’origine, le conservatisme correspond à un courant de pensée qui s’est constitué en réaction à la Révolution française et à la modernité. Cela ne m’empêche pas pour autant de le prendre en compte librement, en faisant la part des choses entre les aspects réactionnaires au sens propre du terme – à savoir la condamnation globale, voire la diabolisation de la Révolution française et de la modernité, avec l’illusion d’un possible retour en arrière –, et l’éclairage critique qu’il apporte sur la condition de l’homme moderne et la vie en société. À sa façon, ce courant de pensée rappelle que l’histoire ne commence pas à la Révolution française ; il souligne les limites et les ambiguïtés du projet moderne d’émancipation dans sa prétention à ériger la raison et l’individu en références ultimes, faisant fi des héritages culturels passés ; il remet en question la croyance en un progrès nécessairement positif de l’humanité et une conception de l’homme « naturellement bon », le mal n’étant que l’effet du conditionnement d’une mauvaise société et d’un pouvoir oppresseur.
Dans le courant du XIXe et du XXe siècle, le courant conservateur s’est développé et renouvelé en menant une critique de la révolution industrielle, de l’urbanisation et de la massification qui, là aussi, met en lumière des aspects bien réels de la modernité, sans qu’on soit obligé pour autant d’épouser les problématiques globales dans lesquelles cette critique s’insère et les engagements politiques qui ont pu l’accompagner. Le conservatisme n’en a pas moins mis en question l’idée même de « révolution » en tant qu’elle implique une rupture radicale et la construction d’un monde et d’un homme nouveau en faisant table rase du passé. Les totalitarismes ont poussé jusqu’au bout ces idées avec les ravages que l’on connaît.
Que nous le voulions ou non, ce courant de pensée conservateur fait partie de notre héritage et nous pouvons en tirer profit, pour autant que nous opérions un discernement entre ce qui peut apparaître comme ses « branches mortes » et son apport de vérité dans son interprétation des évolutions de la société et du monde. Telle est du moins ma façon d’envisager mon rapport au conservatisme. Elle s’inscrit dans la problématique de la modernité et des Lumières en considérant que la rupture avec la tradition, loin d’être une tare, est au contraire être une condition favorable à l’enrichissement de la réflexion. Comme Hannah Arendt l’a souligné, c’est précisément parce que nous vivons dans un monde qui n’est plus structuré par une autorité et une tradition qui s’imposeraient d’elles-mêmes, qu’il nous est possible d’entretenir un rapport plus libre, plus lucide à cette tradition. Dans les conditions de la modernité et face aux évolutions problématiques de la démocratie, le conservatisme peut être considéré comme une des manifestations de l’esprit de liberté pour qui l’autonomie de jugement demeure une exigence et qui trouve dans le passé des ressources qui nous aident à mieux comprendre et affronter les défis du présent.Q : Le conservatisme développe une vision pessimiste, il est associé à un discours de déploration qui n’offre guère d’alternative… N’est-ce pas là l’une des principales raisons pour laquelle l’appellation de « conservateur » est si peu revendiquée en France ?
Jean-Pierre Le Goff : Le pessimisme est un des traits du conservatisme qui s’oppose à un optimisme naïf qui considère que l’histoire marche toujours dans le sens du progrès, en amalgamant en un tout progrès des sciences, des techniques et progrès culturel et moral. Le totalitarisme et les barbaries du siècle passé et présent ont, pour le moins, mis à mal un tel optimisme. L’histoire nous apprend que les civilisations naissent, se développent, passent par des périodes de crise et sont mortelles. On est ainsi en droit de s’interroger sur l’état de la dynamique de la modernité au sein même de l’Europe et considérer que nous vivons une période particulièrement critique de notre histoire. La démocratie a ses propres ambivalences et son développement n’a rien d’une marche inéluctable, quand bien même ce développement passerait par des crises conçues comme inhérentes à l’idée même de démocratie, ou comme des phases transitoires d’une expansion historique continue. Nous ne sommes pas maîtres de l’histoire et nous n’en détenons pas les clés d’interprétation. S’il y a bien de l’irréversible et des tendances lourdes, tout n’est pas joué d’avance ; l’histoire est ambivalente et tragique, elle demeure ouverte sur des possibles dans des conditions données, et il importe de savoir dans quel monde nous voulons vivre. Ce pessimisme n’est donc pas synonyme de retrait et d’inaction, il est au contraire « actif », un stimulant de la réflexion et de l’action pour qui se soucie des désordres du monde.
Ce pessimisme concerne également une conception de l’être humain qui reconnaît en lui une part sauvage, irréductible, d’agressivité et de destruction. Pour reprendre, les propos de Freud dans Malaise dans la civilisation qui retrouve, à sa façon, une conception qui est bien antérieure à la psychanalyse : « L’homme n’est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont on dit qu’il se défend quand on l’attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d’agressivité. […] Cette tendance à l’agression que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons à bon droit l’existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans nos rapports avec notre prochain ; c’est elle qui impose à la civilisation tant d’efforts [1]. » Cette tendance n’a pas disparu, malgré les efforts d’un nouveau moralisme pour la dénier ou l’éradiquer. Le conservatisme me paraît faire preuve de lucidité salutaire face au règne des bons sentiments et à une vision angélique de l’être humain et des droits de l’homme.
Mais, il faut aussi le reconnaître, le conservatisme a ses penchants négatifs lorsqu’il méconnaît l’ambivalence de la démocratie et ses acquis, lorsqu’il flirte avec l’idée d’un âge d’or et d’un retour en arrière. Replié sur lui-même, il tend à idéaliser le passé et verse dans l’amertume et la déploration sans fin. Il peut devenir une posture morale et esthétique qui juge d’en haut le monde moderne, souvent du reste avec talent et des constats critiques judicieux. Plus sommairement, il peut se nourrir des traits négatifs de la modernité qu’il dénonce, s’enfermer dans un face à face délétère avec le progressisme bien pensant où les postures comptent plus que l’échange des arguments. Le conservatisme devient alors incohérent et flirte avec le nouvel air du temps. On peut dénoncer la société du spectacle et les médias tout en rêvant d’en être, en faisant jouer sa posture comme élément de distinction. Il devient alors le vis-à-vis obligé de ses adversaires qui s’en servent comme un repoussoir caricatural pour mieux éviter toute confrontation sur le fond. En fait, les conservateurs d’aujourd’hui sont proches des « antimodernes » qu’a bien caractérisés Antoine Compagnon, lorsqu’il parle de « modernes à contrecœur », « déchirés [2] » et « déçus [3] ».Q : Si la critique du progressisme n’est pas nouvelle, elle semble trouver aujourd’hui en France une vigueur nouvelle – critique des contradictions de la démocratie, du libéralisme sociétal, du « droit-de-l’hommisme », de l’égalitarisme – ce que certains associent de façon négative à l’émergence d’une pensée « réactionnaire ». N’est-ce pas là plutôt le signe d’une certaine crise du progressisme ?
Jean-Pierre Le Goff : Il faut d’abord prendre la mesure des bouleversements qui se sont opérés dans le dernier siècle, face à un optimisme de façade qui tend à dénier la décomposition historique que nous connaissons. Le développement économique, scientifique et technique s’est accompagné de changements sociétaux qui ont mis en question tout une culture humaniste. La Grande Guerre, qui marque l’entrée dans le XXe siècle, et les totalitarismes qui l’ont suivie n’ont pas seulement mis à mal l’idée d’une marche inéluctable de l’histoire vers toujours plus de progrès – dans laquelle communisme et socialisme s’inscrivaient, chacun à leur manière –, ils ont fait peser un doute profond sur les capacités émancipatrices de notre propre culture, comme si les guerres et les totalitarismes du XXe siècle avaient tout dévasté sur leur passage et empêchaient désormais toute réappropriation. Le christianisme, les conceptions des Lumières, l’idée de progrès issue de la Révolution française et du XIXe siècle… sont entrés en crise. C’est tout un creuset anthropologique et culturel, une façon d’être, de se situer par rapport au monde, aux autres, à la collectivité qui se sont érodés et ont été mis en cause. Portée au départ par des « avant-gardes » révolutionnaires et artistiques minoritaires, la rupture avec cet héritage culturel s’est progressivement répandue dans la société.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les sociétés démocratiques ont franchi une nouvelle étape de leur histoire, marquée à la fois par le développement de la production, de la consommation et, dans le dernier quart du siècle, par les « désillusions du progrès [4] » et les préoccupations écologiques. Ce tournant s’est accompagné d’une relecture particulièrement critique de notre propre histoire et une érosion de la dynamique des sociétés démocratiques européennes. Une partie des démocraties européennes s’est ainsi déconnectée de l’histoire, le passé étant considéré sans ressources, obsolète, et l’avenir chaotique et indiscernable. Notre héritage culturel et politique passé n’a pas seulement donné lieu à une relecture réflexive et critique dans un souci de vérité, mais il a été l’objet d’un règlement de compte historique qui l’a rendu responsable de tous les maux de l’humanité. Il s’est ainsi opéré un grand retournement. La remise en cause salutaire de l’ethnocentrisme a basculé vers la perte de confiance en ses propres ressources et la mésestime de soi. Au sein de certains pays européens, particulièrement en France, s’est développé une mauvaise conscience liée à une focalisation sur les pages sombres de notre histoire qui a abouti à une vision pénitentielle qui n’en finit pas.
Le paradoxe de la construction de l’Union européenne est qu’elle s’est développée dans un moment où son héritage premier qui la spécifie comme civilisation s’est trouvé mis à mal. Le défunt traité établissant une Constitution pour l’Europe élaboré en 2004 faisait non seulement peu de cas des nations qui se sont construites suite aux empires, il se référait de façon éthérée dans son préambule à des références certes louables (« dignité humaine », « liberté », « égalité », « solidarité », « démocratie », « État de droit »…) mais sans ancrage historique. Les principales sources et les grands moments qui ont façonné l’Europe et la distinguent des autres civilisations n’étaient même pas mentionnées : culture grecque et romaine, juive et chrétienne, sécularisation et importance des Lumières qui ont fait de l’Europe le « continent de la vie interrogée »... Cette difficulté à assumer sa spécificité historique est allée de pair avec l’importance accordée à l’économie, et plus précisément à une politique économique particulière, néo-libérale, qui acquérait de fait un statut constitutionnel dans le défunt Traité. Cette politique économique se trouvait ainsi promue comme l’une des normes fondamentales de la démocratie, au même titre que les libertés publiques fondamentales et les règles juridiques qui encadrent l’organisation et le fonctionnement des institutions. L’économisme est devenu la grille de lecture dominante de pays européens déboussolés qui ne parviennent plus à réinsérer l’économie dans un creuset historique et culturel qui puissent faire sens pour les peuples.Q : Dans vos écrits, vous êtes particulièrement critique sur la modernisation et le management tels qu’ils se sont développés depuis les années 1980. N’est-ce pas là la manifestation d’un certain conservatisme qui peut rejoindre la défense des intérêts corporatistes et refuse les réformes ?
Jean-Pierre Le Goff : Il s’agit avant tout de comprendre que le « néolibéralisme », la « modernisation » ou encore les « réformes » se sont développés depuis un quart de siècle dans le cadre global de cette déculturation historique. Celle-ci constitue une situation nouvelle, en rupture avec le libéralisme traditionnel et les modernisations antérieures. À l’origine, le libéralisme est inséparable de la lutte pour la liberté politique et, sur le plan économique, il s’est accompagné de l’idée selon laquelle le marché libre, le libre jeu des intérêts et de la concurrence, entrainaient la prospérité des nations. Quoiqu’on puisse penser de cette conception économique dont je ne partage pas l’optimisme et le caractère utopique, ce libéralisme est né dans une situation historique particulière et il était lié à une visée éducative des individus dans le cadre d’une collectivité historique [5]. Qu’en est-il aujourd’hui de ce libéralisme des origines, avec une mondialisation marquée par la spéculation et une logique de court terme, qui étend considérablement le champ de la concurrence avec des pays hétérogènes, passant outre aux différences du coût du travail, à l’histoire économique et sociale propre à chaque pays ?
Répondre à cette question suppose de sortir de l’économisme et d’une optique technocratique et gestionnaire, pour prendre en compte les bouleversements culturels – en termes d’idées, de valeurs, de représentations et de comportements qui imprègnent la société – qui se sont opérés dans les années 1970 et 1980. Et plutôt que de dénoncer le « capitalisme » ou la « dictature des marchés », il faut poser la question autrement : que s’est-il passé dans le dernier quart du XXe siècle pour que le marché, et avec lui l’entreprise, soient érigés en nouveaux pôles de légitimité sociale et en modèles pour l’ensemble des activités ? Ce qui amène à s’interroger sur les raisons d’un aveuglement qui ont conduit une partie des élites à adhérer si facilement à une conception angélique de la libre concurrence et de la mondialisation. Autrement dit, qu’en est il de nos ressources politiques et morales, intellectuelles et culturelles qui ont constitué autant de garde fous contre le libre jeu de la concurrence et l’hégémonie du modèle marchand ?
Ce nouveau libéralisme et l’économisme qu’il implique dans l’abord des questions de société ont été accompagnés d’une modernisation d’un nouveau genre qui a pratiqué la « fuite en avant » dans tous les domaines, rompant ainsi avec les modernisations antérieures. Après la défaite de juin 1940, la passion modernisatrice de l’après-guerre entendait tirer un trait sur la France de l’avant-guerre, repliée sur elle-même, par une vision d’avenir marquée du sceau du développement économique, scientifique et technique. Cette vision modernisatrice n’en impliquait pas pour autant une dépréciation de l’histoire de France et de sa culture, bien au contraire. L’arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958 s’est inscrite dans cette modernisation entamée par la IVe République en lui redonnant un nouveau souffle. En fait, le général de Gaulle incarnait une « alliance singulière entre vision classique et moderne » : la modernisation était l’instrument par lequel la France, identité historique séculaire, pouvait rester égale à elle-même en jouant de nouveau un rôle historique dans le monde [6].
Ce « roman national » qui maintenait le lien entre le passé, le présent et l’avenir du pays, se trouve aujourd’hui en morceaux. Dans une situation où ce continuum historique est rompu, où le passé est déprécié, réduit au « devoir de mémoire » et à la dimension patrimoniale, où l’avenir paraît indiscernable, ouvert sur de possibles régressions, le présent est existentiellement flottant, il devient autoréférentiel et le vide qui le sous-tend est alors comblé par un activisme dans tous les domaines de la vie individuelle et collective. Le slogan « le changement, c’est maintenant » exprime bien cette absolutisation du présent en état de sollicitation perpétuelle. Dans cette temporalité devenue folle, individus et collectivités sont constamment sommés de rattraper un retard qui paraît sans fin. Les grands médias audio-visuels fonctionnant en boucle, les nouvelles techniques d’information et de communication renforcent et démultiplient ce phénomène mais ils ne l’ont pas créé.
Désarticulée de l’histoire, la politique a elle-même versé dans l’activisme managérial et « communicationnel », faute de projet plus structurant. Cette façon de faire est particulièrement manifeste dans la succession des réformes menées par les différents gouvernements. Celles-ci s’inscrivent dans ce moment de déculturation où la politique est dominée par une optique étroitement gestionnaire et comptable qui, étant dépourvue de creuset humaniste et de vision historique, apparaît non pas comme un moyen mais comme un fin. Cette déculturation et cette fuite en avant concernent l’école qui s’est trouvée de plus en plus soumise à une logique d’adaptation de courte vue, aux pressions des idéologies et des modes dans les domaines de la pédagogie et des mœurs, comme dans celui des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui exercent une véritable fascination. Pour le modernisme ambiant, la finalité conservatrice de l’école apparaît désormais comme une survivance d’un autre âge, alors qu’elle est un élément essentiel de la transmission, du maintien et du renouvellement d’un monde commun. Ses missions ne se réduisent pas à l’apprentissage de compétences de base, pour importantes qu’elles soient, elles relèvent en même temps de la transmission d’une culture à travers un corpus structuré de connaissances qui ne sont pas seulement scientifiques et techniques, mais aussi historiques, avec une importance particulière accordée à la littérature, aux arts et à la philosophie qui sont indispensables à la compréhension du monde et à l’autonomie de jugement. Pour ces raisons, l’école ne se confond pas avec l’espace public ; elle doit se protéger des communautarismes et des groupes de pression qui font valoir leurs idéologies et leurs intérêts. Dans ce cadre, la défense de la laïcité issue de notre tradition républicaine trouve son bien fondé.
La fuite en avant moderniste s’étend également aux mentalités et aux modes de vie emportés dans un changement perpétuel, sans finalité autre que celles de la survie et de la concurrence dans un monde chaotique. Si le monde et notre héritage culturel ne sont pas immuables, on ne saurait faire valoir comme modèle a contrario un mouvement permanent, indéfini, et un multiculturalisme invertébré, à moins de considérer que notre faculté de penser et de juger est désormais hors de propos. C’est précisément ces idées que diffusent les rhéteurs de la postmodernité qui commentent indéfiniment les évolutions et veulent à tout prix apparaître dans le camp d’un « progrès » devenu synonyme de « changement » sans but ni sens. Pour une partie des élites, l’important c’est d’« en être », en faisant du surf sur les évolutions et en essayant de tirer parti d’une telle situation. Face à cette insignifiance, les questions fondamentales : « Qu’est-ce qui est vrai ? », « Qu’est-ce qui est juste ? », « Qu’est-ce que je peux en penser ? » sont devenues des exigence à la fois conservatrices et très actuelles, à l’heure d’une « réactivité » et d’un zapping permanent qui ne permettent plus la distance et brouillent le discernement.
Une partie du pays en a assez, non pas de la modernité, mais de la fuite en avant moderniste dans une logique de remise en cause et d’accélération permanentes. Telles me paraissent être les points aveugles d’un nouveau management et d’un pouvoir informe qui n’ont cessé de déstabiliser les individus et les collectifs, de générer l’angoisse au sein de la société, rendant ainsi plus difficile une reconstruction qui est tout autant économique et sociale que politique et culturelle.Q : Pourquoi la gauche a-t-elle tendance à tout réduire à la lutte contre les inégalités et à la nécessité d’adapter sans cesse l’homme et la société aux évolutions considérées comme naturellement porteuses de progrès ?
Jean-Pierre Le Goff : Dans sa décomposition actuelle, la gauche bricole un curieux mélange de fuite en avant et de restes morcelés de son ancienne doctrine ; la lutte contre les inégalités est un marqueur d’identité auquel elle se raccroche. Outre le fait qu’il s’agit de prendre en compte de façon pragmatique les effets réels des politiques de lutte contre le chômage de masse et la précarité, l’« égalité » est devenue un mot fourre-tout qui joue de plus en plus un rôle symbolique de démarcation avec la droite. Là aussi, il faut opérer un retour aux sources pour mieux comprendre le glissement qui s’est opéré.
La liberté est la première des valeurs inscrites dans la devise républicaine et l’égalité est d’abord juridique et politique : elle implique l’égalité des citoyens devant la loi et l’élection de leurs représentants par le suffrage universel. La conception de la citoyenneté républicaine met en avant une exigence, celle du dépassement des intérêts particuliers et des appartenances particulières pour se penser membre de la cité. Cette conception a un caractère d’idéalité qui ne peut complètement coïncider avec les faits, mais elle n’en constitue pas moins un « idéal régulateur » face au repli sur les particularismes individuels, sociaux ou religieux. La lutte contre les inégalités économiques s’inscrit dans le cadre d’une « justice sociale » et vise à créer les conditions favorables à cette citoyenneté. C’est en s’inscrivant dans cette perspective que la lutte contre les inégalités prend son sens et ne verse pas dans l’égalitarisme et le ressentiment. Dans cette optique, il s’agit d’améliorer les conditions économiques et sociales, de développer l’éducation, particulièrement en direction des catégories les plus défavorisées, afin d’accroître cette liberté et de former des élites issues du peuple. Les paroles de Carlo Rosselli, socialiste, antifasciste italien, assassiné en 1937, constituent le meilleur de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier : « Le socialisme, disait-il, c’est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres [7]. » La dynamique historique qu’ont pu représenter le mouvement ouvrier et le socialisme n’est plus, mais cette idée d’une liberté concernant les couches populaires est une exigence à laquelle je demeure attaché. Celle-ci n’a rien à voir avec les revendications du « droit à la réussite pour tous » et des « droits à » de la part des individus ou des groupes communautaires, revendications qui ont été promues de façon démagogique par une gauche en crise d’identité.
Plus globalement, la gauche reste encore largement prisonnière d’une lecture réductrice de la société : le domaine économique et social demeure le fondement de la réalité, le point focal à partir duquel elle interprète les phénomènes. Les questions anthropologiques n’échappent pas à cette problématique. Elles sont encore envisagées le plus souvent comme des phénomènes superstructurels ou des « constructions sociales de la réalité » marqués du sceau des inégalités et de la domination, qu’il faut adapter aux évolutions considérées comme naturellement porteuses de progrès, avec ce même point aveugle de certitude : la gauche est nécessairement dans le camp du progrès et du Bien. Dans l’ensemble, la gauche manque de liberté d’esprit pour aborder ces questions : peu ou prou, il faut relier ces phénomènes à la sphère marchande, aux inégalités, à la domination… pour qu’ils acquièrent une légitimité suffisante et que la gauche puisse s’y retrouver avec des repères sécurisants face la droite, alors que ces questions engagent une conception de la condition humaine dont on ne peut faire abstraction et qui ne recoupe pas les clivages partisans. Les difficultés théoriques de la gauche dans l’abord de ces questions se conjuguent avec la crainte d’être catalogué dans le mauvais camp. On vit dans un « entre-soi » où l’on tient à conserver à tout prix à une image progressiste, de gauche, en ayant peur d’avoir « mauvaise réputation », d’être catalogué comme un « nouveau réactionnaire » ou un suppôt de l’extrême droite. La confusion intellectuelle et le relativisme de bon ton se conjuguent avec une forme de lâcheté face à la pression et aux anathèmes d’un milieu restreint mais influent qui occupe des positions de pouvoir dans les médias et la communication. Dans ces conditions, il s’agit de faire valoir la liberté de pensée et l’autonomie de jugement face à une gauche repliée sur elle-même et sectaire, incapable de comprendre ce qui lui arrive, pratiquant l’invective et se servant de l’extrême droite pour masquer sa propre inconsistance et dénier la réalité. Resituée dans un temps long, cette dégradation me paraît typique de la fin d’un cycle historique, celui du mouvement ouvrier issu du XIXe siècle et du pôle qu’il pu représenter dans la société.Q : Peut-on dire que le concept de « gauchisme culturel » que vous avez développé et critiqué, s’oppose à la conception d’une gauche positivement conservatrice ?
Jean-Pierre Le Goff : En effet, le gauchisme culturel s’oppose au conservatisme qu’il assimile à la réaction et à l’extrême droite de façon des plus caricaturales. Ce gauchisme culturel paraît pacifique et non violent, dans la mesure où il entend « changer les mentalités » par les moyens de l’éducation, de la communication moderne et par la loi. Mais il n’en véhicule pas moins l’idée de rupture avec le « vieux monde » et de « révolution culturelle », en étant persuadé qu’il est porteur de valeurs et de comportements correspondant à la fois au nouvel état de la société et à une certaine idée du Bien. Plus fondamentalement, il s’inscrit dans un courant déstructurant présent au sein des sociétés démocratiques qui met à mal toute une conception de la condition humaine et un sens commun qui lui était attaché.
Les origines, le contenu et la genèse de ce gauchisme sont inséparables du basculement opéré par le mouvement de mai 68. En France, cet événement multiforme marque un moment de pause et de catharsis dans une société qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’est trouvée transformée en peu de temps par la modernisation des Trente glorieuses [8]. Mai 68 a fait apparaître au grand jour la jeunesse adolescente comme nouvel acteur social, il a mis en question les finalités du progrès, mis en cause le moralisme et le paternalisme, les bureaucraties en place, les pouvoirs et les institutions sclérosés… En ce sens, il n’appartient à personne et l’on ne reviendra pas en arrière. Ce qui m’apparaît avant tout en question est ce que j’ai appelé son « héritage impossible » qui comporte une remise en cause radicale des symboles de l’autorité, une conception de l’autonomie érigée en absolu, une vision noire de notre histoire… Cet héritage impossible a été transmis de génération à génération, passant par une dynamique contestataire et transgressive pour aboutir à un nouveau conformisme et à une forme de nihilisme d’affaissement [9].
Les années qui ont suivi mai 68 ont d’abord été marquées par un règlement de compte d’une génération contestataire, celle des « baby boomers », contre l’héritage culturel et politique qui lui avait été transmis, tant bien que mal, dans une société marquée par le développement sans précédent de la production, de la consommation et des loisirs. Les gauchistes de l’époque qui prétendaient faire table rase du passé n’en étaient pas moins des héritiers, des héritiers rebelles mais des héritiers « quand même ». Ils se sont révoltés contre les cultures juive et chrétienne, humaniste et républicaine, mais ils avaient été éduqués dans leur creuset. Toute rupture se voulant radicale est marquée par une référence (fût-elle en négatif) à ce qui est légué par les générations antérieures. N’oublions pas, au demeurant, que Rimbaud, élevé au rang d’icône de la révolte et de l’artiste maudit, n’en a pas moins été d’abord un lycéen brillant qui a obtenu des premiers prix des concours académiques de vers et de discours en latin.
Les générations post-soixante-huitardes ont grandi et ont été formées dans une période critique où les éducateurs et les enseignants assumaient mal leur rôle de transmission d’un héritage avec lequel ils étaient eux-mêmes en rupture. À cette rupture dans la transmission est venu s’ajouter un retournement de la situation avec la fin des Trente glorieuses, le développement du chômage de masse et les préoccupations écologiques. Le premier « fossé des générations » des années 1960-1970 a été suivi d’un second pour qui mai 68 est devenu un sorte de mythe fondateur dans un contexte bien différent. Une culture post soixante-huitarde abâtardie dont le gauchisme culturel est l’héritier, s’est progressivement distillée et installée dans la jeunesse.
Aujourd’hui, les figures du « révolté » et du « rebelle », de l’« artiste maudit » et du « génie méconnu » sont devenues des modèles de référence dans la société du spectacle, aboutissant à un résultat paradoxal : celui d’un nouveau conformisme de la révolte et de la transgression banalisées qui s’étalent dans les milieux médiatiques et branchés. Dans le même temps, les thèmes de la souffrance et de la victime ayant des droits ont pris le dessus.
Au fil de plusieurs générations, tout un public adolescent et post-adolescent a baigné dans une sous-culture historique et idéologique pour qui l’absolutisme, l’esclavagisme, le colonialisme, Pétain et la collaboration, la Shoah… constituent le résumé de l’histoire de la France, de l’Europe et de l’Occident. En contrepoint, les autres cultures du monde exercent leur fascination sous un angle des plus angéliques. Cette sous-culture gauchiste est entretenue et diffusée par des politiques et des journalistes militants, des groupes de pression minoritaires qui font valoir leur statut de victimes pour s’ériger en justiciers du passé, faire prévaloir leur idéologie et leurs intérêts particuliers. Ils encouragent le ressentiment et pratiquent la délation, le lynchage médiatique et les plaintes en justice. De cette façon, ils ont réussi à paralyser une partie de la gauche et l’empêchent de penser librement, en même temps qu’ils laissent le champ libre à l’exploitation populiste des problèmes qu’ils dénient, en faisant de l’extrême droite leur adversaire attitré. Aujourd’hui, ce gauchisme culturel me paraît être parvenu à un point limite. Son agitation et son influence dans certains milieux intellectuels et médiatiques peuvent laisser croire qu’il occupe toujours une place prépondérante alors qu’une bonne partie de la population le rejette ou l’ignore. Au sein de la société, après l’hégémonie culturelle de l’héritage impossible de mai 68, nous assistons à un mouvement de balancier avec des aspects traditionalistes et réactionnaires bien réels, sans qu’on puisse réduire ce mouvement à ces aspects.
Ce qui me frappe le plus, c’est la légèreté et la précipitation avec lesquelles la gauche convertie au gauchisme culturel aborde les questions sociétales au nom de l’égalité sans se rendre compte que cette dernière a changé de registre. La « passion de l’égalité » propre à la démocratie a franchi une nouvelle étape en s’appliquant désormais à des domaines qui relèvent de l’anthropologie. Une donnée de base de la condition humaine reconnue comme telle depuis des millénaires a été mise en question : la division sexuelle et la façon dont les êtres humains conçoivent la transmission de la vie et de la filiation. On s’excusera du peu… En se voulant à l’avant-garde d’une évolution des mœurs problématique, la gauche a ouvert en toute irresponsabilité une boîte de Pandore. Désormais, avec la nouvelle conception de la lutte contre les inégalités, les différences liées à la condition humaine et les aléas de la vie peuvent être considérés comme des signes insupportables d’inégalité et de discrimination. Cette revendication bien particulière de l’égalité a partie liée avec un fantasme de toute puissance qui considère que les problèmes anthropologiques sont une sorte de matière qu’on pourrait modeler à loisir et sans dommage, en fonction des désirs de chacun et des minorités qui font valoir leur statut de victimes ayant des droits. À l’inverse, parce qu’elles mettent en jeu ce qui fait l’humain, ces questions anthropologiques me paraissent devoir être considérées avec prudence et le plus grand soin, pour empêcher que le monde humain se défasse. Le « principe de précaution » – qui est devenu un leitmotiv concernant des espèces en voie de disparition ou de certaines recherches et expérimentations scientifiques et techniques – est mis hors champ concernant l’humain, au nom d’une passion de l’égalité sans limite. Dans ces domaines, le conservatisme est une forme de sagesse, de prudence et de résistance face à un nouvel hubris qui se veut décomplexé dans un climat de confusion intellectuelle et éthique.
Q : Le conservatisme peut-il être de droite autant que de gauche ?
Jean-Pierre Le Goff : Aujourd’hui, dans les conditions historiques et idéologiques que je viens de décrire, c’est un courant de pensée pluriel qui n’est pas réductible à un camp ; il me paraît transversal à la droite et à la gauche, même si la droite a pu être son représentant pendant longtemps et si la gauche s’est toujours présentée comme le camp du progrès contre la réaction assimilée au conservatisme. L’écologie qui s’interroge sur l’avenir de la planète et n’appartient pas à un camp politique, est à sa façon conservatrice. Bien plus, tout un courant écologique fondamentaliste est réactionnaire, voire nihiliste, dans sa façon de remettre en cause la prééminence de l’homme sur la nature et ce qui fait précisément la spécificité de l’humain qui n’est pas, contrairement à ce qui est asséné, une « espèce comme les autres ». Il est également un domaine sur lequel une partie de la gauche peut apparaître « conservatrice », c’est celui de la défense d’un modèle social lié à l’État providence qui s’est constitué dans la période dite des Trente glorieuses et qui connaît de sérieuses difficultés aujourd’hui. S’il n’est pas intangible, le modèle social français est le fruit d’une histoire et de conquêtes sociales dont on ne peut faire abstraction en prônant ouvertement une « révolution culturelle » qui le mettrait à bas, comme le fait une partie de la droite libérale. Là aussi, il s’agit de faire la part des choses, de façon pragmatique et non idéologique, à gauche comme à droite, entre ce qui relève des idéologies et des dogmes et d’une adaptation nécessaire d’un modèle auquel je demeure attaché.
L’économie de marché a ses lois propres, mais elle s’insère aussi dans un creuset anthropologique et historique. L’économisme dominant passe outre cette dimension essentielle à la vie en société et à la politique. Un pays n’est pas une entreprise et la culture n’est pas une sorte de « pâte à modeler » ou de « supplément d’âme » à une société conçue comme une mécanique gérable et adaptable à volonté ; elle est précisément ce qui donne sens à la vie en société.
Cette approche conservatrice qui s’inscrit dans la modernité trouve plus globalement sa pertinence face à un nouvel individualisme désaffilié et autocentré, à une déculturation politique et culturelle. Il s’agit très directement de savoir si nous avons encore des motifs pour croire que nos repères culturels et politiques, transmis tant bien que mal à travers les générations, peuvent encore nous inspirer et nous guider, si notre pays peut encore apporter quelque chose de spécifique à l’Europe et au monde. C’est précisément sur ce point que les choses sont devenues floues pour beaucoup, non seulement parce qu’elles seraient plus « complexes » qu’auparavant, mais, plus simplement et plus fondamentalement, parce que beaucoup ne savent plus trop quoi penser et transmettre.
C’est dans ce cadre, qu’être conservateur peut trouver une signification nouvelle en mettant en question l’insignifiance, en faisant valoir l’importance d’un recul réflexif et critique, inséparable d’une relecture et d’une réappropriation éclairée de notre passé. Il s’agit de sortir du faux choix, sous forme de chantage, dans lequel tout un courant de la gauche, mais aussi de la droite moderniste, enferme l’alternative et le débat entre un passé, un héritage culturel figé et dépassé qui n’auraient plus rien de substantiel à nous apporter, et un présent et un avenir perpétuellement mobiles et fluides auxquels nous n’aurions plus qu’à nous adapter.
Tout un courant intellectuel gauchiste et moderniste réduit bêtement les notions d’« identité » et de « culture » à une conception essentialiste qui nous ramènerait du côté du traditionalisme, de Maurras, de Pétain, de l’extrême droite… L’identité d’un peuple n’est pas une substance immuable qui ne changerait pas avec le temps, mais on ne saurait faire valoir comme modèle a contrario un mouvement permanent et indéfini, sauf à considérer le monde commun comme un chaos et à abdiquer toute prétention à le rendre signifiant. L’idée d’« identité narrative » développée par Paul Ricœur ouvre d’autres perspectives en soulignant l’importance du récit qu’un pays se forge de sa propre histoire. Cette identité n’est pas celle d’une « structure fixe, mais bien celle mobile, révisable, d’une histoire racontée et mêlée à celle des autres cultures [10] ». Cette identité narrative ne signifie pas pour autant un multiculturalisme invertébré et soumis à une recomposition constante ; elle suppose une interprétation qui implique des choix, structure les événements, leur donne une signification et met en valeur des potentialités inexploitées du passé. La France et les pays de l’Union européens n’échappent pas aujourd’hui à cette nécessité.
Le passé n’est pas un patrimoine muséifié, il ne comporte pas seulement en lui du révolu, il contient des ressources et ce que Paul Ricœur appelle des « potentialités inaccomplies », pourvu que nous sachions les redécouvrir et nous approprier le meilleur de nos traditions. En ce sens, être conservateur ne signifie pas être « traditionaliste » ou « réactionnaire », contrairement à ce que voudraient nous faire croire une gauche bien pensante et une droite moderniste. Un pays qui rend insignifiant son passé se condamne à ne plus inventer un avenir discernable porteur des espérances d’émancipation ; un pays qui ne croit plus en lui-même est ouvert à toutes les servitudes. Dans ce cadre, conservatisme et progrès ne me paraissent pas contradictoires, ils constituent les deux pôles d’une modernité éclairée qui rejette le faux dilemme entre traditionalisme et fuite en avant. En fin de compte, il importe avant tout de savoir ce à quoi l’on tient et ce que l’on veut transmettre pour entreprendre un travail de reconstruction. Pour paraphraser la formulation de Kolakowski, je dirai qu’il est possible d’être à la fois conservateur, moderne et social, dans la mesure où aujourd’hui ces orientations ne me paraissent pas antinomiques.Jean-Pierre Le Goff, propos recueillis par Laetitia Strauch-Bonart (décembre 2014)
Notes
[1] Sigmund FREUD, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, 1988, p. 64 et 65.
[2] Antoine COMPAGNON, Les antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Gallimard, 2005, p. 7.
[3] Ibid, p. 446.
[4] Raymond ARON, Les désillusions du progrès, Gallimard, 1969.
[5] Michel GUENAIRE, Les deux libéralismes, Perrin 2011, et Il faut terminer la révolution libérale, Flammarion 2009.
[6] Edgard PISANI, « De Gaulle et la modernisation de la France », Cahier de Politique Autrement, octobre 1998.
[7] Carlo ROSSELLI, cité par Monique CANTO-SPERBER, Les règles de la liberté, Plon, 2003, p. 13-14.
[8] Cf. « Mai 68 : La France entre deux mondes », Le Débat, n° 149, mars-avril 2008.
[9] Cf. Mai 68, l’héritage impossible, La Découverte, 1998, 2002, 2006 et 2015.
[10] Paul RICŒUR, « Identité narrative et communauté historique », Cahier de Politique Autrement, octobre 1994.
 Dans la seconde moitié du XXe siècle, les sociétés démocratiques ont franchi une nouvelle étape de leur histoire, marquée à la fois par le développement de la production, de la consommation et, dans le dernier quart du siècle, par les « désillusions du progrès
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les sociétés démocratiques ont franchi une nouvelle étape de leur histoire, marquée à la fois par le développement de la production, de la consommation et, dans le dernier quart du siècle, par les « désillusions du progrès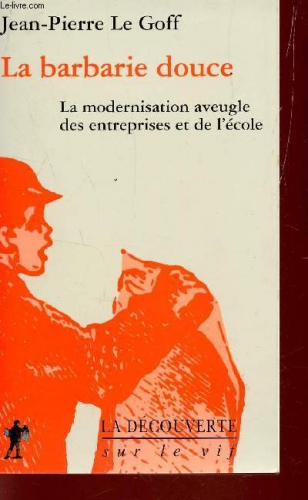 La fuite en avant moderniste s’étend également aux mentalités et aux modes de vie emportés dans un changement perpétuel, sans finalité autre que celles de la survie et de la concurrence dans un monde chaotique. Si le monde et notre héritage culturel ne sont pas immuables, on ne saurait faire valoir comme modèle a contrario un mouvement permanent, indéfini, et un multiculturalisme invertébré, à moins de considérer que notre faculté de penser et de juger est désormais hors de propos. C’est précisément ces idées que diffusent les rhéteurs de la postmodernité qui commentent indéfiniment les évolutions et veulent à tout prix apparaître dans le camp d’un « progrès » devenu synonyme de « changement » sans but ni sens. Pour une partie des élites, l’important c’est d’« en être », en faisant du surf sur les évolutions et en essayant de tirer parti d’une telle situation. Face à cette insignifiance, les questions fondamentales : « Qu’est-ce qui est vrai ? », « Qu’est-ce qui est juste ? », « Qu’est-ce que je peux en penser ? » sont devenues des exigence à la fois conservatrices et très actuelles, à l’heure d’une « réactivité » et d’un zapping permanent qui ne permettent plus la distance et brouillent le discernement.
La fuite en avant moderniste s’étend également aux mentalités et aux modes de vie emportés dans un changement perpétuel, sans finalité autre que celles de la survie et de la concurrence dans un monde chaotique. Si le monde et notre héritage culturel ne sont pas immuables, on ne saurait faire valoir comme modèle a contrario un mouvement permanent, indéfini, et un multiculturalisme invertébré, à moins de considérer que notre faculté de penser et de juger est désormais hors de propos. C’est précisément ces idées que diffusent les rhéteurs de la postmodernité qui commentent indéfiniment les évolutions et veulent à tout prix apparaître dans le camp d’un « progrès » devenu synonyme de « changement » sans but ni sens. Pour une partie des élites, l’important c’est d’« en être », en faisant du surf sur les évolutions et en essayant de tirer parti d’une telle situation. Face à cette insignifiance, les questions fondamentales : « Qu’est-ce qui est vrai ? », « Qu’est-ce qui est juste ? », « Qu’est-ce que je peux en penser ? » sont devenues des exigence à la fois conservatrices et très actuelles, à l’heure d’une « réactivité » et d’un zapping permanent qui ne permettent plus la distance et brouillent le discernement. Les origines, le contenu et la genèse de ce gauchisme sont inséparables du basculement opéré par le mouvement de mai 68. En France, cet événement multiforme marque un moment de pause et de catharsis dans une société qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’est trouvée transformée en peu de temps par la modernisation des Trente glorieuses
Les origines, le contenu et la genèse de ce gauchisme sont inséparables du basculement opéré par le mouvement de mai 68. En France, cet événement multiforme marque un moment de pause et de catharsis dans une société qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’est trouvée transformée en peu de temps par la modernisation des Trente glorieuses Q :
Q : 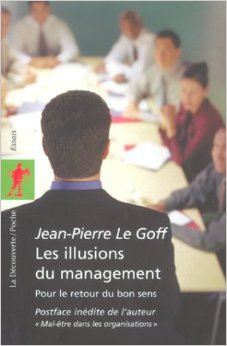 L’économie de marché a ses lois propres, mais elle s’insère aussi dans un creuset anthropologique et historique. L’économisme dominant passe outre cette dimension essentielle à la vie en société et à la politique. Un pays n’est pas une entreprise et la culture n’est pas une sorte de « pâte à modeler » ou de « supplément d’âme » à une société conçue comme une mécanique gérable et adaptable à volonté ; elle est précisément ce qui donne sens à la vie en société.
L’économie de marché a ses lois propres, mais elle s’insère aussi dans un creuset anthropologique et historique. L’économisme dominant passe outre cette dimension essentielle à la vie en société et à la politique. Un pays n’est pas une entreprise et la culture n’est pas une sorte de « pâte à modeler » ou de « supplément d’âme » à une société conçue comme une mécanique gérable et adaptable à volonté ; elle est précisément ce qui donne sens à la vie en société.