
Une certaine idée de la fonction productive
par Daniel COLOGNE
Agréablement présenté, élégamment écrit, abondamment documenté, le dernier livre de Georges Feltin-Tracol suscite, comme de coutume, le plus vif intérêt (1). Je l’ai reçu au moment où je commençais la lecture des nouvelles livraisons d’Éléments et de Réfléchir & Agir.
En feuilletant ces dizaines de pages promises à une passionnante lecture, j’ai eu l’attention attirée par quelques lignes extraites d’un compte-rendu : « La substance du nordicisme consiste en la capacité de l’homme à élever chaque objet du monde physique, matériel, jusqu’à son archétype, jusqu’à son idée (2). »
Le « nordicisme » est ici considéré dans son acception évolienne de lumière boréenne à l’origine de l’indo-européanité et de sa grande triade fonctionnelle. Placée sur le pied inférieur du podium, la fonction productive ne doit cependant pas être négligée par ceux qui souhaitent « l’accomplissement de finalités plus élevées […] Ne méprisons toutefois pas l’économie ! (3) », s’exclame l’auteur, même si elle est naturellement subordonnée au plan politique comme celui-ci est subalterne par rapport à la spiritualité.
Comme tous les domaines du monde manifesté, la fonction productive peut être élevée à son idée archétypale, c’est-à-dire à son origine ou à son principe, selon la riche étymologie du mot grec archè. L’hypothèse de recherche de la présente recension est la suivante : le solidarisme brillamment analysé par Georges Feltin-Tracol serait-il l’idée archétypale de la fonction productive ?
Pour comprendre le sens de ce questionnement, il faut rappeler la doctrine traditionnelle (ou archaïque) des deux natures : la nature physique (ou matérielle) et la nature métaphysique (ou spirituelle). La seconde est propre au monde des idées : peut-être un « arrière-monde » platonicien que beaucoup d’entre-nous récusent en se situant plutôt dans le sillage de Nietzsche. Il est cependant clair qu’une divergence de ce type ne doit en aucun cas fracturer le camp de ceux qui militent pour des « finalités élevées », pas forcément transcendantales (4). Genesis en archè : tels sont, en grec, les trois premiers mots de l’Ancien Testament, titre du premier livre inclus. Ce point alpha (archè) contient en lui toutes les possibilités du devenir (genesis), au premier rang desquelles la dualité distinctive, qui dégénère ensuite en dualisme séparatif. Le concept de bi-unité cher à Thierry Jolif est peut-être le stade de la dualité distinctive le plus proche de l’origine (5).
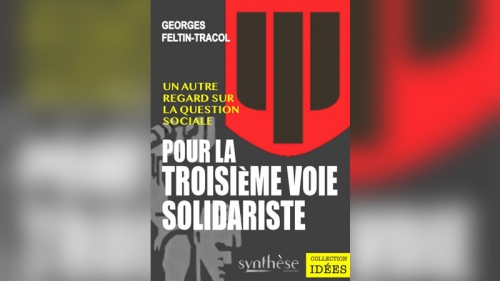
Dans l’ordre de la fonction productive, la bi-unité gestion – exécution, selon les termes de Raymond Abellio (6), pourrait être le point de départ d’une réflexion visant à élever l’économie à son idée archétypale. Le binôme capital – travail serait aussi à appréhender comme une bi-unité, comme l’a très bien compris le « gaullisme de gauche (p. 147) » avec son thème de la « production ». Un chapitre quasi-terminal (7) du livre lui est consacré. L’évocation quasi conclusive de la « participation gaullienne (p. 162) » explique l’intitulé que j’ai choisi pour ma recension, en souvenir d’une célèbre « certaine idée de la France ».
Lorsque qu’éclate la bi-unité proche de l’origine apparaissent, sur le plan socio-économique, des dualismes du type libéralisme – marxisme (quand on prend en considération les matrices philosophiques) ou du genre capitalisme – communisme (si l’on envisage les modèles d’organisation sociale). Il devient alors impératif de partir en quête d’une « troisième voie », d’adopter des « positions tercéristes (p. 43) ». En explorant les « sources de l’erreur libéral (p. 61) » dans le sillage d’Arnaud Guyot-Jeannin, maître d’œuvre d’un livre collectif vieux de vingt ans, Georges Feltin-Tracol épingle le « schisme protestant de 1517 (p. 62) ». Il est certain que les religions réformés sont le véhicule d’un individualisme dissolvant dont les effets se prolongent au sein de multiples sectes et mouvements relevant de ce que Spengler nomme la « seconde religiosité ». On en arrive au point où des déséquilibrés mentaux se prétendent détenteurs de charismes et, dans cette mise en œuvre d’une sorte de contrefaçon de l’Esprit Saint, il convient d’observer avec lucidité la protestantisation du catholicisme.
Poursuivant son tour d’horizon historique, l’auteur décèle d’importants germes de la pensée libérale dans l’Angleterre de 1688 – 1689 (la « Glorieuse Révolution »). S’attaquant aux « communautés bioculturelles », le libéralisme déconstruit l’ordre hiérarchique du monde ancien, dont Éric Zemmour donne une éloquente description : « Les hommes avaient l’habitude de rester dans leur condition. On ne regardait pas en haut avec regret et envie. On se trouvait bien dans son monde (8). » À défaut d’ascenseur social, comme on dit aujourd’hui, il y avait un escalier à « plusieurs étages », où « chacun pouvait gravir toutes les marches du sien, mais pas monter au-delà; arrivé sur le palier, on se heurtait à des portes closes (9) ».
Ainsi pouvait-on, dans l’artisanat traditionnel, fleuron de la fonction productive du monde ancien, être apprenti, puis compagnon, puis maître. La loi Le Chapelier de 1791 abolit « toutes les organisations ouvrières et paysannes sans omettre le compagnonnage professionnel », nous rappelle l’auteur, qui en arrive ainsi à l’époque de la Révolution française. Réagissant contre la confiscation de la Révolution par la bourgeoisie sans pour autant se draper dans une pose réactionnaire, des penseurs comme Blanqui, Proudhon et Sorel, tous trois nés dans la première moitié du XIXe siècle, affichent des « positions tercéristes ». Ils représentent les « socialismes français » qui constituent, sous le gouvernement de Vichy, la matière d’un numéro spécial de la revue Idées (10).
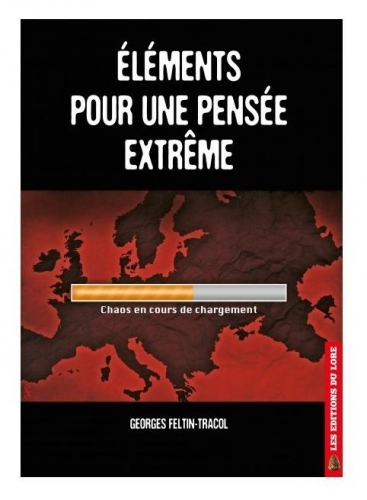
Chef de la Phalange espagnole, José Antonio Primo de Rivera évoque une « inquiétude européenne » face au double péril du totalitarisme soviétique et de la translation atlantiste de l’Occident. La crainte de voir l’Europe disparaître de l’histoire au profit des États-Unis (ceux-ci supplantant la domination biséculaire de l’Angleterre) est le moteur des « fascismes – régimes » (Italie, Allemagne) et des « fascismes – mouvements » (Croatie, Roumanie, Flandre) selon la subtile distinction de Maurice Bardèche (maintes fois cités, notamment pp. 42, 54, 58 et 59). Parallèlement aux fascismes, qui se profilent déjà comme une « troisième voie », le mouvement des « non-conformistes des année Trente » peut aussi revendiquer une position tercériste, voire une analogie avec la « Quatrième Théorie » d’Alexandre Douguine, puisqu’ils récusent le libéralisme et le marxisme, mais aussi le fascisme.
Lecteur attentif des Hommes au milieu des ruines, Georges Feltin-Tracol rappelle qu’Evola est favorable à un « droit de co-direction, co-gestion et co-détermination (p. 86) » permettant aux ouvriers, ainsi déprolétarisés, de participer à la direction des entreprises. Toutefois, « il faudrait également envisager, au détriment des ouvriers, une participation aux pertes éventuelles (Evola, cité p. 87) », parallèlement à la possibilité d’une participation aux bénéfices. Au moment même où les idées politiques et socio-économiques d’Evola pénètrent en France, les GNR (Groupes nationalistes-révolutionnaires) animés par François Duprat et Jean-Gilles Malliarakis découvrent le solidarisme russe, dont une des branches les plus importantes est l’Alliance populaire des travailleurs et solidaristes russes, (NTS) « fondée en juillet 1930 à Belgrade par de jeunes émigrés russes blancs (p. 127) ».
Malgré « l’implacable répression des organes soviétiques de sécurité (p. 129) », la NTS s’attelle à un patient travail de démantèlement du système marxiste-léniniste. Elle est relayée dans cette tâche de longue haleine par d’autres mouvements d’inspiration sociale-chrétienne, dès 1964, ensuite à l’approche de la Perestroïka (groupes fondés par le protestant Victor Roth en 1987 et le dissident Ossipov en 1988). Mais dès la première moitié des années 1970, parallèlement au succès des livres de Soljenitsyne, le solidarisme russe fait des émules en France, tandis que les éditions L’Âge d’Homme publient Berdiaeff, l’un des « pères philosophes » du mouvement. On voit apparaître des revues intitulées Jeune Nation solidariste et Cahiers du Solidarisme. La revue Renaissance de Genève, futur organe du GNR de Suisse romande et de Haute-Savoie, et la revue Horizons européens de Paris, animée par un cercle de celtisants réunis autour de Pierre Lance, font un écho sonore aux dissidents russes et à l’« Église du silence » évoquée par le pasteur Wurbrandt, tout en explorant en Afrique des positions tercéristes qui tentent de dépasser la stérile alternative capitalisme – communisme.
Gaspard Grass publie dans Renaissance un article sur la « troisième voie libyenne ». Georges Feltin-Tracol estime en effet que Mouammar El-Kadhafi veut « sortir du cercle des régimes réformistes et de leurs solutions partielles » tout en brisant l’hégémonie bipolaire du « système capitaliste pourri » et de la « société bureaucratique oppressive » (propos du Guide libyen cités p. 51). Quant aux rédacteurs d’Horizons européens, ils soutiennent la résistance de l’Angolais Jonas Savimbi contre « le gouvernement communiste pro-castriste de Luanda ». « Refusant la présence militaire de La Havane et de Moscou, Savimbi ne se soumettait pas non plus aux exigences de Londres et de Washington (p. 49) ». « Au risque de choquer quelques âmes sensibles (p. 51) », l’auteur range parmi les doctrines tercéristes l’islamisme partisan de la restauration du califat et la tendance néo-ottomane du président turc Erdogan. Quant à l’« islam chiite iranien (p. 52) », il est intéressant d’apprendre que sa révolution de 1979 a une dette philosophique importante envers Ahmad Fardid, disciple de l’Allemand Martin Heidegger. La « persévérance dans l’Être », cet effort heideggérien contre l’oubli ontologique, permet de trancher les deux têtes de l’hydre libérale : l’effacement des origines et l’édification d’un « homme nouveau » façonné par ceux qu’Éric Zemmour appelle les « pédagogistes », c’est-à-dire un homme affranchi de tout respect envers l’histoire, la culture générale et la maîtrise du langage.
À l’opposé d’Heidegger, la quête de l’Autre « dans la nudité de son visage (Levinas) » ne peut servir de fondement à un projet de société et ne s’observe qu’à travers d’exceptionnelles (et parfois admirables) aventures, comme celle du Père Damien parmi les lépreux de Molokaï. Un écrivain flamand a pu écrire que, face au Père Damien, « nous sommes tous des Pharisiens ». « Distinguer de nos jours le socialisme de la gauche semble aberrant tant l’opinion les associe dans une catégorie commune, indivisible et homogène (p. 25). » On peut en dire autant de la démocratie et du libéralisme et c’est pourquoi il faut saluer l’excellent dossier de la revue Éléments sur les « démocraties illibérales (12) ».
Jean-Claude Michéa est un des penseurs actuels qui contribue le mieux à la dissipation de ces malentendus. Il est donc normal que Georges Feltin-Tracol le cite (p. 63) et passe en revue sa bibliographie (p. 88) riche de six titres, auxquels il faut ajouter le recueil paru à l’occasion de la Coupe du Monde de football 2018 (13). L’éminent penseur de Montpellier s’interroge sur la capacité du football d’échapper à la gangrène du « capitalisme absolu » qui fait déjà tant de dégâts dans d’autres secteurs des « industries du divertissement (p. 12) ». Michéa mise sur l’attractivité d’un football « socialiste » héritier du passing game des premiers clubs ouvriers, opposé au dribling game glorifiant l’exploit individuel et incarné par l’Autriche (années 1930), la Hongrie (années 1950) ou, plus près de nous, la dominatrice équipe espagnole (2008 – 2012) à l’ossature barcelonaise. Peut-être vaudrait-il mieux parler d’un football « solidariste » se distinguant du « football de spéculation », car l’expression « football libéral » ne me semble pas appropriée aux conceptions tactiques défensives d’un Herrera (Italie des années 1960) ou, tout récemment, des Français Jacquet et Deschamps (14).
Il est difficile de trouver un vocable susceptible de remplacer le terme « socialisme ». C’est pourtant indispensable dans la mesure où le socialisme a perdu toute crédibilité, d’abord en faisant sien le progressisme libéral au tournant des XIXe et XXe siècles, ensuite en délaissant, depuis un demi-siècle, les masses laborieuses, ouvrières et paysannes, au profit de toute une série de minorités prétendument discriminées, dont les litanies victimaires s’invitent à la table des « problèmes de société » (avortement, euthanasie, peine de mort et « mariage pour tous », les deux derniers servant de déclics décisifs pour des élections présidentielles). On peut dire que el solidarisme est le signifiant substantif idéal, même s’il faut rester vigilant. En Belgique, la Mutualité Socialiste a été rebaptisée Solidaris. L’auteur a aussi pensé au « justicialisme » argentin de Peron, mais la référence à une doctrine sud-américaine pourrait être négativement connotée par le lourd passé de cette région du globe, le souvenir des juntes militaires, une fâcheuse propension à la violence. Jusqu’à nouvel ordre, optons donc pour le solidarisme, troisième voie entre le libéralisme et le sociétalisme, condition d’un « nouvel ordre économique et social » tel que le présente en 1997 Bruno Mégret. Celui-ci « dépeint sans forcer le trait la situation économique et sociale désastreuse de la France à la veille du lancement de la monnaie unique européenne qu’il a violemment combattue (p. 96) ».
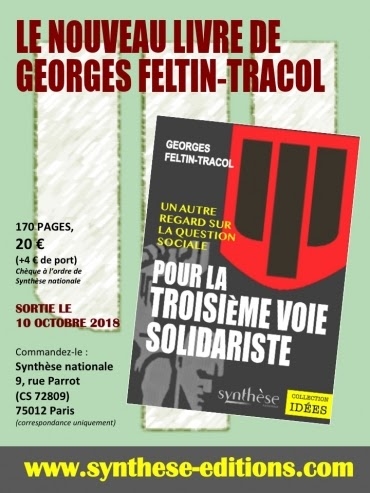 Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. « Après l’avoir sommairement aménagé, le Bastion socialva accueillir en priorité des sans-abris d’origine française. En effet, pendant que des travailleurs précaires dorment dans leur véhicule, des familles françaises endettées sont expulsées sans ménagement de leur foyer, et des clochards abandonnésdans la rue par des autorités peu charitables, les mêmes autorités offrent aux clandestins sans-papiers de bonnes conditions d’accueil. Écœurés et scandalisés par ce traitement franchementdiscriminatoireà l’encontre des nôtres au profit des autres, l’ami Steven Bissuel et son équipe entendent y remédier un petit peu (p. 15). »
Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. « Après l’avoir sommairement aménagé, le Bastion socialva accueillir en priorité des sans-abris d’origine française. En effet, pendant que des travailleurs précaires dorment dans leur véhicule, des familles françaises endettées sont expulsées sans ménagement de leur foyer, et des clochards abandonnésdans la rue par des autorités peu charitables, les mêmes autorités offrent aux clandestins sans-papiers de bonnes conditions d’accueil. Écœurés et scandalisés par ce traitement franchementdiscriminatoireà l’encontre des nôtres au profit des autres, l’ami Steven Bissuel et son équipe entendent y remédier un petit peu (p. 15). »
Je m’en voudrais d’achever la présente recension sans attirer l’attention des lecteurs sur le chapitre consacré à Jean Mabire (pp. 31 – 42) qui est tout le contraire d’une « figure de proue de l’extrême droite fascisante (l’historien Pierre Milza, cité p. 31) ». Certes, il a collaboré à des publications comme Minute, National Hebdo et Le Choc du Mois, mais il y rencontra souvent l’incompréhension de ses collègues en raison de son « régionalisme normand », de son « enthousiasme européen » et d’un socialisme héritier des « socialismes endogènes français (p. 32) ». Le socialisme de Jean Mabire est « élevé à la puissance identitaire (p. 30) » à condition de distinguer trois échelons d’identité : la petite patrie (patrie charnelle, région), la grande nation forgée par l’histoire et l’idée européenne conçue comme « empire sans impérialisme (15) ». Cette identité triscalaire repose sur la combinaison des « mémoires locales », des histoires nationales et de la « volonté continentale », pour reprendre les termes employés par Georges Feltin-Tracol dans un autre livre paru en 2011.
Dans la mesure où le socialisme de Jean Mabire se situe dans la ligne de Babeuf, de Saint-Simon, de Fourier et, bien sûr, de Georges Sorel, cette autre figure de la Normandie, il constitue une « troisième voie » solidariste. En effet, ces socialismes français n’étaient pas « à gauche ». Ils s’opposaient à la fois à la gauche libérale et à la droite réactionnaire, comme le rappelle un historien trop méconnu dans un ouvrage de 2001 (Marc Crapez, cité p. 38). Georges Feltin-Tracol précise : « L’Affaire Dreyfus permettra la convergence de la gauche institutionnelle et du socialisme sur des prétextes laïques et anticléricaux. »
Le socialisme de Jean Mabire est donc une « position tercériste » enrichie d’une vision géopolitique comparable à celle de Raymond Abellio. En filigrane d’un passage de La torche et le glaive (1994), Georges Feltin-Tracol se demande si Jean Mabire « entrevoyait l’aire océanique Pacifique comme le pôle probable de l’ultra-modernité (p. 36) ». Après s’être confondu avec l’Europe, l’Occident a glissé vers l’Atlantique, constate Abellio, et d’une manière plus générale, vers les grandes espaces maritimes. Sur les rivages de ceux-ci surgissent les « villes-mondes » qui fascinent parfois les poètes. Toi qui pâlis au nom de Vancouver, écrit Marcel Thiry (16). Un renversement de signification s’opère par rapport au Nord-Ouest tel qu’il est conçu dans le monde de la Tradition. La région nordico-occidentale s’identifie au séjour des bienheureux dans la mythologie grecque. C’est vers le Nord-Ouest que court le sanglier de Calydon (17) poursuivi par la troupe des guerriers dont la chasseresse Atalante prend la tête. Rappelons que le sanglier est le symbole de la caste sacerdotale chez les Celtes et un avatar de Vishnou dans l’âge d’or du manvantara hindou. Au Nord-Ouest de Bruxelles, le roi-bâtisseur Léopold II rêvait de voir se dresser un Panthéon de style antique dédié aux « gloires nationales » belges. La pression des milieux catholiques a généré la monumentale Basilique du Sacré-Cœur et son immense parvis où Jean-Paul II a célébré une messe mémorable lors de sa visite en Belgique en 1985.
Le Nord-Ouest hyper-moderne inverse complètement le sens traditionnel de cette zone que privilégient, non seulement le « paganisme assumé (p. 31) » de Jean Mabire, mais aussi quelques extraits de l’Ancien Testament. Le « soir » est cité avant le « matin » dans le récit des sept jours bibliques (18), ce qui donne une primauté de la moitié Nord sur la moitié Sud de la sphère cosmique. Si l’attribution du Couchant à la tribu sacerdotale est implicite, il est par ailleurs très clair que le Levant est lié à la tribu royale. En toute rigueur métaphysique, la tribu sacerdotale est Lévi campe au centre du cercle tandis que le campement de la tribu royale de Juda se situe à l’Est (19). Au lever du Soleil, la marche des Hébreux reprend sous la direction de la tribu de Juda tandis que la tribu de Lévi est protégée au milieu de la caravane. Le devenir (genesis) est gouverné par les « hommes de puissance » (Abellio), pour autant que la puissance ne soit pas l’élan vital bergsonien, mais la permanence heideggerienne de l’« Estre » (archè).
Il m’a été impossible de suivre Georges Feltin-Tracol dans toutes ses analyses des théoriciens solidaristes, dont certains m’étaient d’ailleurs totalement inconnus. Mais une des principales missions de son livre est précisément d’inciter les militants de notre mouvance à s’intéresser de près à l’entreprise, car elle « va être le conservatoire de valeurs indispensables dans les temps difficiles qui risquent bien de s’annoncer (Philippe Schleiter, cité p. 111) ». Des entreprises fonctionnant selon la combinaison des valeurs d’hiérarchie et de solidarité peuvent tisser, sur les ruines laissées par les ravages de l’hyper-modernité, une toile d’araignées comparable au réseau des monastères du Haut Moyen Âge qui sauvegardèrent le sublime idéal contemplatif après l’essor des qualités non moins respectables des Romains légionnaires, juristes, constructeurs de routes et bâtisseurs d’amphithéâtres.
Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le choc pétrolier (période que l’on a appelée les « Trente Glorieuses »), on a pu avoir l’impression que la « pluie d’or » promise par les libéraux anglais du XVIIIe siècle dégoulinait du sommet vers la base de la pyramide sociale. Mais les décennies suivantes ont déchiré le voile de l’illusion et il est urgent de sortir du « chaos social » en promouvant le solidarisme, dont Georges Feltin-Tracol montre brillamment qu’il s’inscrit dans une vieille tradition de pensée française. De même que la construction européenne des années 1950 s’est faite autour de préoccupations économiques, industrielles (charbon, acier) et énergétiques (Euratom), ainsi le solidarisme peut-il être la base d’une Europe sociale appelée à gravir les étages supérieurs de la politique et de la spiritualité. Cette Europe impériale future retrouverait ainsi son rayonnement d’autrefois que lui assigne sa position géographique (20). Cette Europe ne serait plus « occidentale », mais « hespériale (21) », selon le terme suggéré par Heidegger, en liaison avec le mythe du Jardin des Hespérides où Héraklès cueille les « pommes d’or ».
Ouvrant la voie à une Europe organique unissant ses nations et ses régions tout en respectant leur diversité, le solidarisme est la « révolution nécessaire » telle que l’ont pensée dans les années 1930 les non-conformistes Robert Aron et Arnaud Dandieu (plusieurs fois cités, notamment pp. 90 et 93).
Le livre de Georges Feltin-Tracol doit garnir la bibliothèque de toutes celles et de tous ceux qui ne veulent pas se laisser broyer par la tenaille dont les deux mâchoires sont, d’une part l’ultra-libéralisme, d’autre part une gauche que la fièvre des questions sociétales a éloignée du monde du travail confronté aux périls du déclassement social et du déficit identitaire.
Daniel Cologne
Notes
1 : Le recueil de Georges Feltin-Tracol, Pour la troisième voie solidariste, comporte des textes de conférences, des articles mis en ligne et des contributions à diverses revues, comme Salut public ou le bulletin des Amis de Jean Mabire.
2 : Note de lecture par Georges Feltin-Tracol des Mystères de l’Eurasie d’Alexandre Douguine, dans Réfléchir & Agir, n° 60, automne 2018, p. 56.
3 : Georges Feltin-Tracol, Pour la troisième voie solidariste, p. 86. Dorénavant, les numéros de page seront intégrés au texte.
4 : Rappelons le « mono-idéisme » d’Ananda Kentish Coomaraswamy (une première Idée supérieure aux autres), par rapport auquel, selon Maurice Maeterlinck, le Dieu des chrétiens, le Yahvé judaïque et l’Allah musulman sont des « ombres déformées ». Le passage du « mono-idéisme métaphysique ou monothéisme religieux constitue, selon Georges Vallin, la première mort de Dieu ».
5 : Primordialeest évidemment la bi-unité Homme – Femme. Voir à ce sujet la métaphysique du sexe développée par Julius Evola et le thème traditionnel de l’Androgyne, dont la rêverie d’un monde asexué d’Élisabeth Badinter est une pitoyable contrefaçon.
6 : cité p. 42, Raymond Abellio est porteur d’une vision géopolitique sur laquelle je reviendrai plus loin lorsqu’il sera question de Jean Mabire.
7 : Le tout dernier chapitre aborde l’« ergonisme » de Jacob Sher, ingénieur – électricien né en 1934 à Wilno (l’actuel Vilnius en Lituanie), alors territoire polonais, dans une famille communiste juive.
8 : Éric Zemmour, Destin français, Albin Michel, 2018, p. 307.
9 : Idem, p. 308.
10 : Souvenir personnel d’une conversation de 1978 avec Maurice Gaït, directeur de Rivarol.
11 : René Guénon s’installe en terre d’islam en Égypte en 1930. D’aucuns se méfient de certains guénoniens qui semblent favorables à une islamisation de l’Europe, conjointement à la permanence d’un « parti de l’étranger » sur le sol français (cf. à ce sujet Éric Zemmour, op. cit., se référant lui-même au Bloc-Notes de François Mauriac).
12 : dans Éléments, n° 174, octobre – novembre 2018.
13 : Jean-Claude Michéa, Le plus beau but était une passe. Écrits sur le football, Climats, 2018.
14 : Rappelons quand même que c’est le club ouvrier londonien Arsenal qui a prôné le premier renforcement défensif, avec l’entraîneur Chapman, dont le disciple Butler a entraîné le Daring de Bruxelles, le club de ma jeunesse, d’obédience alors libérale.
15 : Il faut prendre l’expression dans le sens inverse de celui que luia donné Manuel Barroso. Il ne s’agit pas d’une Europe qui renonce à la puissance et se laisse effacer de l’histoire. Doter l’Europe d’une force dissuasive est aussi une « troisième voie » entre le pacifisme naïf et l’agressivité belliqueuse.
16 : Après s’être inspiré de ses voyages, Marcel Thiry (1897 – 1972) célèbre l’identité wallonne. Bien que né à Charleroi, il exalte la région liégeoise et tout le cours de la Meuse qui va de Maizieres à Rotterdam. À la fin de sa vie, il milite pour la fin de a Belgique unitaire et la fédéralisation du pays.
17 : Dans Symboles de la Science sacrée, Guénon rapproche Calydon de Calédonia, l’ancien nom de l’Écosse situé au Nord-Ouest de l’Europe.
18 : Les 34 premiers versets de la Genèse, qui peuvent être lus selon la série numérique dorée 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34, sont une sorte d’épure. À partir du verset 35, le récit devient plus chaotique avec l’expulsion du Jardin d’Éden, le meurtre d’Abel par Caïn, la fondation de la première ville par le même Caïn.
19 : La Bible, Nombres, chapitre 2, versets 1 à 31 « Organisation du camp d’Israël ».
20 : Voir spécialement dans dans Réfléchir & Agir, n° 60, l’article sur le général – baron von Lohausen (pp. 44 – 46), en particulier, p. 45, l’image cartographique montrant la centralité de l’Europe dans l’hémisphère Nord, « le plus couvert de terres ».
21 : dans Éléments, n° 174, p. 94, reprise d’un article de Guillaume Faye de 1980, « Pour en finir avec la civilisation occidentale ».
• Georges Feltin-Tracol, Pour la troisième voie solidariste. Un autre regard sur la question sociale, Éditions Les Bouquins de Synthèse nationale, coll. « Idées », 170 p., 20 € (+ 4 € de port).